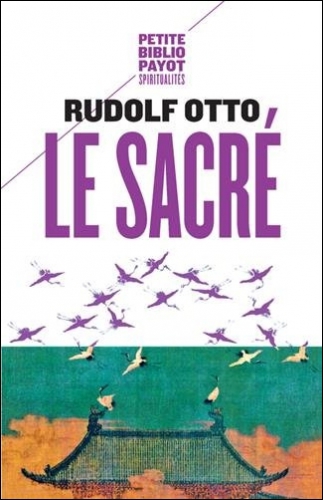 J’attendais beaucoup de ce livre. Sans doute quelque chose de l’ordre d’une révélation. Une définition de ce après quoi je cours. Et je l’ai lu finalement comme j’aurais lu un livre dans une langue étrangère que je ne maîtrise pas. Le sacré m’est resté impénétrable. La philosophie en général m’est inaccessible, et la philosophie religieuse n’a pas fait exception.
J’attendais beaucoup de ce livre. Sans doute quelque chose de l’ordre d’une révélation. Une définition de ce après quoi je cours. Et je l’ai lu finalement comme j’aurais lu un livre dans une langue étrangère que je ne maîtrise pas. Le sacré m’est resté impénétrable. La philosophie en général m’est inaccessible, et la philosophie religieuse n’a pas fait exception.
Je veux tenter de retenir quelques éléments de définition du numineux tel que le qualifie Rudolf Otto. Le mysterium tremendum dans un premier temps, autrement nommé « le mystère qui fait frissonner » ou l’effroi mystique, la « frayeur de Dieu » largement relayée par l’Ancien Testament notamment. Le mystère est aussi le « tout autre ». En tête de chapitre, Rudolf Otto cite sur ce point Tersteegen : « Un dieu compris n’est pas un dieu ».
La majestas ensuite, l’absolue supériorité de puissance. Et l’énergie finalement : « il se fait sentir d’une manière particulièrement vive dans l’orgè ; c’est à lui que se rapportent les expressions symboliques de vie, de passion, de sensibilité, de volonté, de force, de mouvement, d’excitation, d’impulsion » . L’orgè signifiant la colère divine, je ne peux m’empêcher de faire le lien avec Shakti, qui d’énergie deviendra bientôt la déesse terrifiante par excellence, créatrice et destructrice. Particulièrement présent dans le mysticisme de l’amour selon Rudolf Otto, cet élément me renvoie d’autant plus au tantrisme des shakta.
A ces trois éléments qui relèvent de la forme du numineux, Rudolf Otto y ajoute comme qualificatif le fascinant, fascinans. Autrement dit, le sacré effraye et fascine à la fois.Une autre caractéristique est « l’énorme », au sens d’épouvantable ou sinistre, maléfique et imposant, puissant et étrange, surprenant et admirable, donnant le frisson et fascinant, divin et démoniaque, et « énergique ». Pour chacune de ces caractéristiques, Rudolf Otto s’appuie sur les textes bibliques et sur les philosophes qui l’ont précédé, de Sophocle à Schleiermacher.
Je ne note rien de la suite de l’essai, je n’en ai rien retenu mis à part un court chapitre sur la manifestation du sacré dans l’art, qui se caractérise alors par le sublime et le grandiose, le geste noble, dont le sentiment du solennel existe depuis l’érection des premiers mégalithes (premières œuvres architecturales). Rudolf Otto souligne que l’on utilise volontiers le terme de « magique » pour certaines œuvres d’arts décoratifs notamment. Le numineux s’associe alors parfois au sublime et dépasse le magique – l’auteur prend pour exemple des statues du Bouddha, la peinture paysagiste et la peinture sacrée des dynasties Tang et Sung en Chine, le gothique en Occident.
Selon Rudolf Otto, l’art est un moyen indirect d’accéder au sacré. En Occident, les deux moyens d’accès directs au sacré sont l’obscurité et le silence. R. Otto cite ensuite le vide spacieux (le désert) comme moyen d’accès direct au sacré, et se réfère à l’architecture et à la peinture chinoises qui savent laisser place au vide dans leurs œuvres.
L’auteur s’attache ensuite à la musique et souligne que l’élément musical le plus sacré est le silence absolu et prolongé.
Il est difficile de ne pas noter le parti pris de Rudolf Otto à la fois dans ses exemples d’art sacré – il ne justifie pas vraiment ce qui distingue la présence du sacré du goût personnel, mis à part le sentiment intime (et inexprimable) qui en résulte. Et surtout à maintes reprises dans l’ouvrage, le christianisme est explicitement cité comme la religion spirituellement supérieure à toutes les autres. Pour un homme qui a consacré sa vie à travailler en parallèle sur les religions asiatiques et occidentales – il a publié par ailleurs Mystique d’Orient et mystique d’Occident – cette apologie chrétienne a eu tendance à m’agacer. [Nota Bene : si l’éditeur le présente comme philosophe, il n’en est pas moins théologien luthérien]
♣♣♣
Extraits :
C’est une loi fondamentale et bien connue de la psychologie que les idées « s’attirent », que l’une excite l’autre et la fait apparaître dans la conscience, si cette autre lui ressemble. Une loi semblable vaut pour les sentiments. Un sentiment peut également faire entrer en vibration un sentiment similaire et me le faire éprouver en même temps. Bien plus, de même que, d’après la loi d’attraction, il se produit, en vertu de la ressemblance, des substitutions d’idées, de telle sorte que l’idée x prend dans mon esprit la place que l’idée y correspondrait exactement. Enfin je puis passer d’un sentiment à un autre et cela par une transition graduelle et imperceptible, par le fait que le sentiment x s’éteint peu à peu, à mesure que le sentiment y, suscité en même temps, croît et augmente d’intensité. Mais en ce cas, ce qui « passe », ce n’est pas en réalité le sentiment lui-même. Ce ,n’est pas lui qui change peu à peu de qualité ou qui « évolue », à vrai dire, qui se transforme en un sentiment tout différent ; c’est moi qui passe d’un sentiment à un autre, d’un état à un autre, par le déclin graduel de l’un et le progrès de l’autre. Le sentiment lui-même ne se transforme pas ; ce serait là une véritable métamorphose, semblable à la transmutation des métaux en or, ce serait une alchimie psychologique.
♣
Comment pourrons-nous arriver à faire nous aussi l’expérience qui consiste à découvrir , dans la personne du Christ, la manifestation du sacré ?
De toute évidence, ce ne sera pas par la voie de la démonstration, au moyen de preuves, d’après une règle ou suivant des concepts. Nous ne pouvons indiquer ici de caractères conceptuels qui se prêteraient à cette forme de raisonnement : « Quand les éléments x + y sont présents, il y a révélation. » C’est précisément pour cette raison que nous parlons de divination et d’appréhension intuitive. Ce ne sera que par la voie de la contemplation dans laquelle notre âme s’ouvre et s’abandonne à la pure impression de l’objet.
♣♣♣
Présentation des idées de Rudolf Otto issue du catalogue d’exposition Au-delà des étoiles : le paysage mystique de Monet à Kandinsky, p. 58 :
Dans les années 1920, le philosophe allemand Rudolf Otto s’est intéressé à la phénoménologie des rencontres avec l’ « Autre sacré », rencontres qui semblent se distinguer quelque peu de l’expérience mystique. Pour lui, le sentiment du sacré renvoie à une réalité surnaturelle, celle d’une immense force et d’une volonté (numen) qui dépasse les connotations morales et rationnelles entourant le concept. Otto décrit la réalité de ces expériences « numineuses » du sacré dans des idéogrammes analogiques qui en font quelque chose d’enchanteur et d’attirant (fascinans) et, en même temps, d’effrayant (tremendum). Ces expériences stimulent chez le sujet une conscience renforcée de son état de créature. Le sacré provoque naturellement l’adoration (majestas) tout en restant un sentiment extraordinaire, insolite, étrange et au-delà de toute compréhension (mysterium).
♣♣♣
Notes sur Rudolf Otto et Le Sacré extraites de Wikipédia :
Biographie
Rudolf Otto (25 septembre 1869 – 6 mars 1937) est un théologien luthérien, également universitaire en religion comparée, de nationalité allemande.
Rudolf Otto dans Le Sacré a proposé le terme de « numineux » pour qualifier cette sphère au-delà de l’éthique et du rationnel, qui se présente sous le double aspect d’un mystère effrayant et fascinant. […]
Le Sacré
L’ouvrage le plus célèbre d’Otto, Le Sacré, publié en 1917 sous le titre allemand Das Heilige – Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen (Du sacré – Sur l’irrationnel des idées du divin et de leur relation au rationnel). Il s’agit de l’un des plus grands succès de la littérature théologique allemande du xxe siècle. L’ouvrage a en effet toujours été réédité, et existe actuellement en plus de 20 langues. Otto y définit le concept de « sacré » comme étant numineux, notion qui fait référence à une « expérience non-rationnelle, se passant des sens ou des sentiments et dont l’objet premier et immédiat se trouve en dehors du soi ». Otto crée ce nouveau concept depuis le latin « numen » faisant référence à la divinité. Le numineux est ainsi un mystère ( mysterium), à la fois terrifiant (tremendum) et fascinant (fascinans). Otto propose ainsi un paradigme pour l’étude des religions, se focalisant sur le besoin de réaliser le sentiment religieux, considéré comme non réductible et comme une catégorie en soi. Objet de multiples critiques survenues en 1950 et 1990, le paradigme d’Otto revient sur le devant de la scène avec la philosophie phénoménologique qui, par certains aspects, s’en rapproche.
Influence
Otto a eu une profonde influence sur la théologie et la philosophie des religions, dans la première moitié du xxe siècle. Le théologien américain et allemand Paul Tillich reconnaît son influence sur ses travaux, ainsi que l’anthropologue roumain Mircea Eliade qui utilise les concepts exposés dans Le Sacré dans son ouvrage de 1957, Le sacré et le profane. Son élève, Gustav Mensching (1901-1978), a par ailleurs continué sa pensée. C. S. Lewis reconnaît aussi l’apport d’Otto, notamment dans son étude du « problème de la souffrance » en théologie. D’autres personnalités peuvent enfin être citées, telles : Martin Heidegger, Leo Strauss, John A. Sanford, Hans-Georg Gadamer, Max Scheler, Ernst Jünger, Joseph Needham, Hans Jonas ou encore Carl Gustav Jung qui reprend le concept de « numineux » en psychologie.
Le sacré : l’élément non rationnel dans l’idée du divin et sa relation avec le rationnel – Rudolf Otto
Traduit de l’allemand par André Jundt
Petite bibliothèque Payot, 2015, 285 p.
Traduction française : Payot, 1949
Première publication : Das Heilige : ûber das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen, 1917
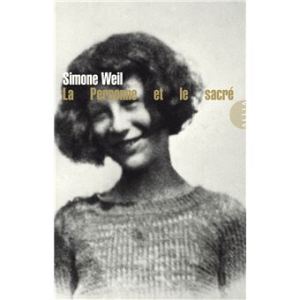

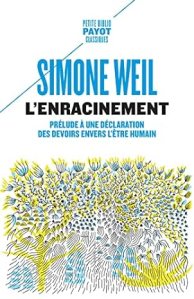
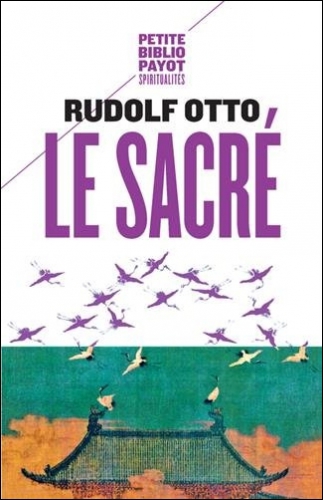 J’attendais beaucoup de ce livre. Sans doute quelque chose de l’ordre d’une révélation. Une définition de ce après quoi je cours. Et je l’ai lu finalement comme j’aurais lu un livre dans une langue étrangère que je ne maîtrise pas. Le sacré m’est resté impénétrable. La philosophie en général m’est inaccessible, et la philosophie religieuse n’a pas fait exception.
J’attendais beaucoup de ce livre. Sans doute quelque chose de l’ordre d’une révélation. Une définition de ce après quoi je cours. Et je l’ai lu finalement comme j’aurais lu un livre dans une langue étrangère que je ne maîtrise pas. Le sacré m’est resté impénétrable. La philosophie en général m’est inaccessible, et la philosophie religieuse n’a pas fait exception.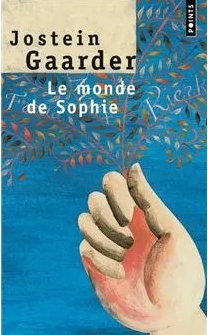 Le monde de Sophie est un ouvrage de vulgarisation de la pensée philosophique depuis les présocratiques jusqu’à Sartre. A destination des adolescents, l’ouvrage est extrêmement accessible et permet de se faire une idée de l’évolution de la pensée humaine sur près de trois millénaires. Il invite également le lecteur à exercer sa propre pensée critique et à se positionner lui-même comme le résultat d’une longue histoire et d’une réflexion qui n’a pas fini de se transformer.
Le monde de Sophie est un ouvrage de vulgarisation de la pensée philosophique depuis les présocratiques jusqu’à Sartre. A destination des adolescents, l’ouvrage est extrêmement accessible et permet de se faire une idée de l’évolution de la pensée humaine sur près de trois millénaires. Il invite également le lecteur à exercer sa propre pensée critique et à se positionner lui-même comme le résultat d’une longue histoire et d’une réflexion qui n’a pas fini de se transformer.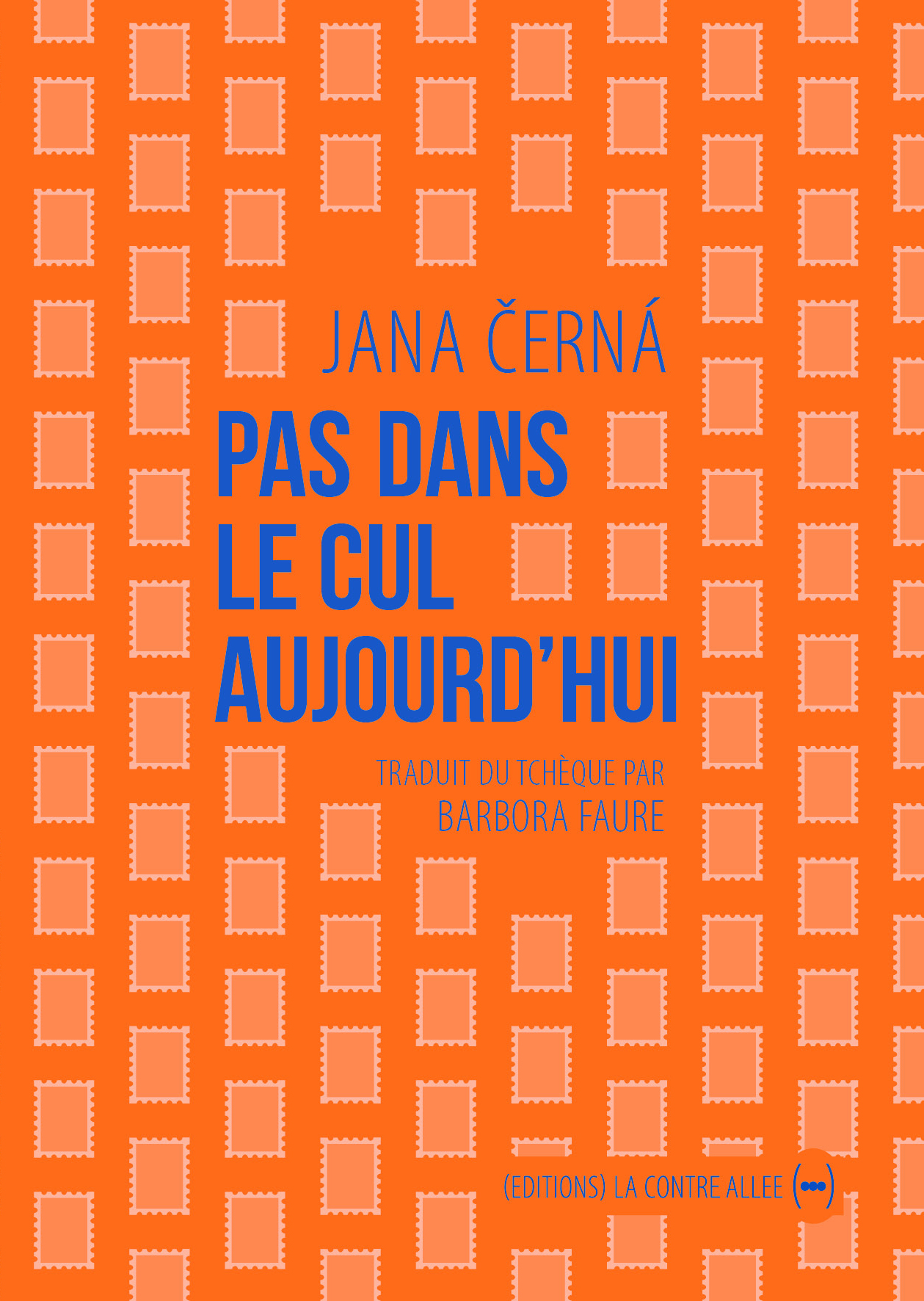 Littérature tchèque à l’honneur ce jour. Pas dans le cul aujourd’hui est une lettre de Jana Černá à son mari Egon Bondy écrite à Prague aux environ de 1962 sous l’ère communiste. Elle se lit en moins d’une heure et soulève des tempêtes, aiguise l’intellect, pourrait être provocante, se contente d’exprimer une pensée totalement et démesurément libre. Jana Černá est la fille de la journaliste, écrivaine et traductrice tchèque Milena Jesenská, célèbre destinataire des Lettres à Milena de
Littérature tchèque à l’honneur ce jour. Pas dans le cul aujourd’hui est une lettre de Jana Černá à son mari Egon Bondy écrite à Prague aux environ de 1962 sous l’ère communiste. Elle se lit en moins d’une heure et soulève des tempêtes, aiguise l’intellect, pourrait être provocante, se contente d’exprimer une pensée totalement et démesurément libre. Jana Černá est la fille de la journaliste, écrivaine et traductrice tchèque Milena Jesenská, célèbre destinataire des Lettres à Milena de 


 Je remonte la piste «
Je remonte la piste « 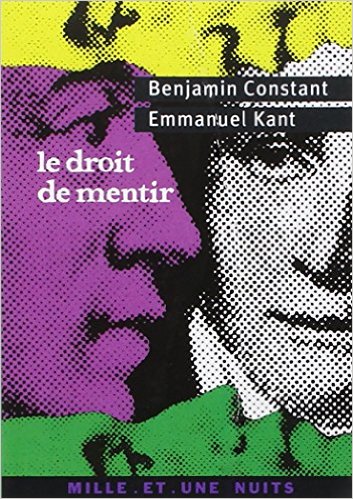 Il m’est peu de choses plus intolérables que d’être face à une personne qui ment ostensiblement et consciemment. Irrémédiablement, celle-ci se transforme à mes yeux en hideux cafard rampant que j’écrase en pensée d’un coup sec du talon avant de lui tourner le dos – oui, je suis parfois excessive dans mes réactions. Non seulement écoeurée de la perte immédiate de confiance en mon interlocuteur, je comprends également le mensonge comme la marque évidente d’une bêtise assumée, d’un déni de l’intelligence saine et de son usage, telle que l’individu qui oserait encore se tenir debout devant moi m’apparait alors absolument indigne de sa qualité d’être humain. Une perte de dignité en bonne et dûe forme qui ne devrait inspirer que honte de lui-même au menteur démasqué. Toutefois, si mes vœux se réalisaient, la vie ne serait tout simplement plus tenable au vu du nombre de mensonges – même minuscules – proférés quotidiennement par tout un chacun – à commencer peut-être (mais vraiment pas très souvent !) par moi-même.
Il m’est peu de choses plus intolérables que d’être face à une personne qui ment ostensiblement et consciemment. Irrémédiablement, celle-ci se transforme à mes yeux en hideux cafard rampant que j’écrase en pensée d’un coup sec du talon avant de lui tourner le dos – oui, je suis parfois excessive dans mes réactions. Non seulement écoeurée de la perte immédiate de confiance en mon interlocuteur, je comprends également le mensonge comme la marque évidente d’une bêtise assumée, d’un déni de l’intelligence saine et de son usage, telle que l’individu qui oserait encore se tenir debout devant moi m’apparait alors absolument indigne de sa qualité d’être humain. Une perte de dignité en bonne et dûe forme qui ne devrait inspirer que honte de lui-même au menteur démasqué. Toutefois, si mes vœux se réalisaient, la vie ne serait tout simplement plus tenable au vu du nombre de mensonges – même minuscules – proférés quotidiennement par tout un chacun – à commencer peut-être (mais vraiment pas très souvent !) par moi-même.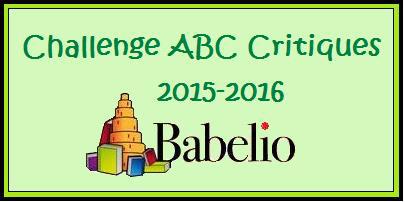
 Voilà un essai que je voulais lire depuis bien longtemps, depuis la lecture de
Voilà un essai que je voulais lire depuis bien longtemps, depuis la lecture de 
 La lecture de
La lecture de 