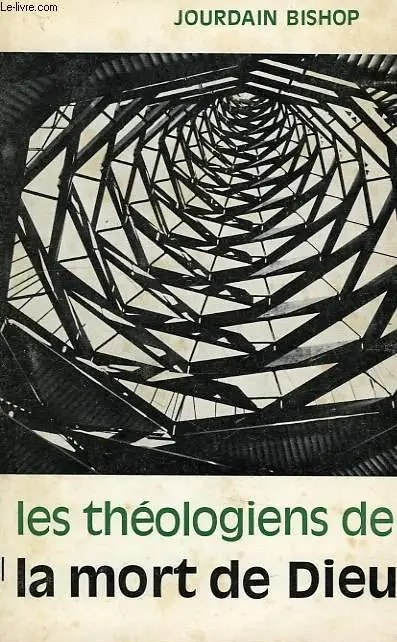Je me plais parfois à dire que j’ai commencé à lire en 2013. Si je veux être exacte, j’ai plutôt re-commencé à lire en abondance début 2013 en ouvrant L’homme qui rit de Victor Hugo. Je n’ai pas chroniqué ce roman ici parce qu’il m’est très difficile de formuler décemment son caractère monumental. Je crois que je n’exagèrerais pas si je vous disais que je l’ai vécu comme une révélation. Depuis L’homme qui rit, les écrits de Victor Hugo tiennent place de fil rouge dans mes lectures et dans ma vie : Han d’Islande, Les contemplations, L’année terrible et aujourd’hui La légende des siècles se sont succédé tour à tour sur ma table de chevet ou dans mon sac à main.
Je me plais parfois à dire que j’ai commencé à lire en 2013. Si je veux être exacte, j’ai plutôt re-commencé à lire en abondance début 2013 en ouvrant L’homme qui rit de Victor Hugo. Je n’ai pas chroniqué ce roman ici parce qu’il m’est très difficile de formuler décemment son caractère monumental. Je crois que je n’exagèrerais pas si je vous disais que je l’ai vécu comme une révélation. Depuis L’homme qui rit, les écrits de Victor Hugo tiennent place de fil rouge dans mes lectures et dans ma vie : Han d’Islande, Les contemplations, L’année terrible et aujourd’hui La légende des siècles se sont succédé tour à tour sur ma table de chevet ou dans mon sac à main.
J’ai pris connaissance de l’essai d’Emmanuel Godo grâce aux notes de bas de page de Religions : les mots pour en parler. L’auteur le citait en exemple d’un travail de recherche sur l’homo poeticus. J’ai consciencieusement noté la référence pour y revenir au moment opportun. Dans son livre, Emmanuel Godo nous propose de retracer l’évolution spirituelle de Victor Hugo à partir, essentiellement, de son œuvre littéraire, particulièrement prolifique sur la question religieuse. Il met ainsi de côté l’homme politique pour se focaliser sur un aspect peut-être moins connu du grand homme : sa relation à Dieu.
Victor Hugo et Dieu : bibliographie d’une âme est un essai de 250 pages, pas trop long et très accessible. Il n’est pas nécessaire d’être agrégé de lettres modernes pour le comprendre. Truffé de citations de Victor Hugo, c’est un vrai plaisir à lire, invitant à découvrir d’avantage encore l’auteur concerné. L’ouvrage est divisé en 11 chapitres correspondant chacun à une étape de la vie de Victor Hugo, présentée dans l’ordre chronologique. Chaque période possédant ses caractéristiques spirituelles propres.
Né en 1802 à Besançon, on apprend que Victor Hugo n’a reçu aucune éducation religieuse, il n’était pas baptisé. Vers 1819, il admet être passé « du royalisme voltairien de sa mère au royalisme chrétien de Chateaubriand ». Mais ce rapprochement du christianisme, fortement lié à ces penchants politiques, ne durera qu’un temps. De 1825 à 1830, Hugo se détache progressivement de l’Église, alors que sa foi s’affermit. Il écrira notamment dans un poème intitulé Tas de pierre :
« Au fond, Dieu veut que l’homme désobéisse. Désobéir, c’est chercher».
Face à l’institution ecclésiale, Victor Hugo prend le parti de Dieu, et avec Dieu celui du peuple – fil rouge de son œuvre littéraire, autant que politique. Le 4 septembre 1843, V. Hugo perd sa fille, Léopoldine. Cette tragédie ouvre alors dans sa vie ce que Maurice Levaillant appelle la crise mystique de Victor Hugo. Emmanuel Godo parle d’exil métaphysique. La souffrance devient un moyen de connaissance pour Victor Hugo : puisque sa fille appartient à l’invisible, le poète consacrera dorénavant sa vie à définir cet invisible. Il faudra plus de 10 ans avant que Victor Hugo ne puisse formuler ce drame en poème, il publiera les Contemplations en 1856. Dans l’intervalle, en 1851, Bonaparte fait son coup d’état et Hugo doit s’exiler physiquement à Bruxelles, puis sur l’ile de Jersey. Commence alors la période des tables tournantes : Hugo s’adonne au spiritisme. Les compte-rendus des Tables sont publiés, on les trouve encore aujourd’hui en édition de poche. Quoique l’on pense de ces activités, il faut retenir que Victor Hugo, lui, y croit : il dialogue ainsi avec sa fille, le Christ, Alexandre le Grand, Dante, Galilée, Shakespeare, etc. Ces expériences prennent fin lorsque l’un des membres du groupe est interné. Pendant ses 19 années d’exil, la foi de Victor Hugo se concrétise à travers certaines de ses plus grandes œuvres : Les Contemplations, La légende des siècles, Les misérables, L’Homme qui rit, etc.
Emmanuel Godo consacre plusieurs pages magnifiques à L’homme qui rit. Il va jusqu’à écrire, discrètement, en note de bas de page :
« Chaos Vaincu est le titre du drame présenté par Ursus [l’un des personnages principaux de L’homme qui rit] et pourrait servir de sous-titre au roman tant la victoire sur le chaos y est centrale : victoire – espérée – de l’esprit sur la matière, des mots sur l’informe, du sens sur la fatalité de l’absurde. »
Comprendra qui voudra mais pour ma part, c’est bien comme cela que j’ai reçu L’homme qui rit : une victoire du sens sur l’absurde. Et merci monsieur Godo d’avoir su le nommer ! Parce que mis à part balbutier « y’a un truc dans ce roman », je n’aurais jamais pu le formuler moi-même…
Pour en revenir à notre histoire, Victor Hugo rentre en France en 1870, c’est la défaite contre la Prusse, puis la Commune. Il publiera l’année suivante L’Année terrible où il retrace les événements des mois précédents. La spiritualité hugolienne est inséparable de ses actes et de ses choix politiques, il montre un soutien indéfectible au peuple qui le lui rend comme il peut, idolâtrant d’avantage l’homme social et politique que l’écrivain inspiré.
En permanence tourné vers le Christ ou vers Dieu – qu’il nomme également de son nom laïc : le Progrès – Hugo a foi avant tout en l’homme et ne reviendra jamais vers l’Église et ses dogmes. Pour résumer la singularité de la démarche de Victor Hugo, Emmanuel Godo écrit :
« C’est un croyant profond et sincère qui refuse les sacrements d’une Eglise en laquelle il ne reconnaît pas les principes spirituels et moraux sur lesquels il a fondé sa vie et non un athée. »
Victor Hugo meurt le 22 mai 1885. Maupassant écrit qu’ « il attendait la mort sans crainte, avec sérénité ». Ses dernières volontés étaient d’être enterré auprès des siens, au lieu de quoi il reposera au Panthéon et ses funérailles laïques feront date dans l’histoire de France. Emile Augier déclare ce jour-là, au nom de l’Académie Française :
« Ce n’est pas à des funérailles que nous assistons, c’est à un sacre. »
Pour tout vous dire, j’avais un peu peur en m’attaquant à l’essai d’Emmanuel Godo. Je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre. Finalement, j’y ai pris beaucoup de plaisir, j’ai appris beaucoup de choses, et surtout j’ai eu envie de continuer à lire encore et encore Victor Hugo, à m’intéresser d’avantage à ce personnage, monstre sacré s’il en est, à comprendre sa démarche singulière fondée sur la liberté, les actes, la quête spirituelle, la beauté aussi, la raison surtout, le social – au sens fort du terme – et la foi bien évidemment. J’ai également épluché la bibliographie en fin d’ouvrage – petit bonheur qui ouvre toujours de nouvelles portes. Outre d’autres essais sur Victor Hugo, je suis curieuse de ces quelques références sur le romantisme et l’histoire de la pensée au XIXème siècle.
Affaire à suivre…
[Cet article a été publié, a posteriori, dans le cadre du Challenge romantique de ClaudiaLucia]


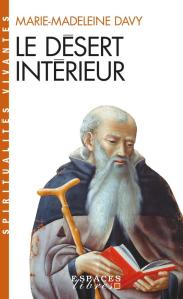
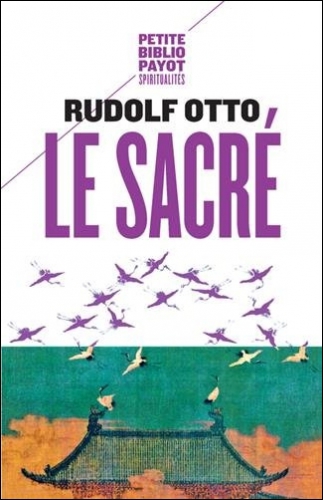 J’attendais beaucoup de ce livre. Sans doute quelque chose de l’ordre d’une révélation. Une définition de ce après quoi je cours. Et je l’ai lu finalement comme j’aurais lu un livre dans une langue étrangère que je ne maîtrise pas. Le sacré m’est resté impénétrable. La philosophie en général m’est inaccessible, et la philosophie religieuse n’a pas fait exception.
J’attendais beaucoup de ce livre. Sans doute quelque chose de l’ordre d’une révélation. Une définition de ce après quoi je cours. Et je l’ai lu finalement comme j’aurais lu un livre dans une langue étrangère que je ne maîtrise pas. Le sacré m’est resté impénétrable. La philosophie en général m’est inaccessible, et la philosophie religieuse n’a pas fait exception. C’est par la publication de ce livre que j’ai appris que François Bœspflug, dominicain et professeur d’histoire de l’art reconnu – et presque vénéré en ce qui me concerne – a quitté l’Ordre dominicain. Renier son engagement ? Et quid alors de sa foi ? Ses écrits, son parcours, son engagement étaient jusqu’alors parmi les rares qui me faisaient dire qu’il y avait peut-être une réponse au non-sens, au néant, dans la foi catholique, ou dans la foi-tout-court, dans la recherche du sacré. Sa vision de la spiritualité m’invitait à croire en autre chose qu’à l’absurde. Il est à noter que l’acceptation de l’absurde me soigne ces temps-ci de bien des névroses, plus qu’une quelconque quête d’un dieu toujours absent. Mais alors, si François Bœspflug lui même renonce, n’existe-t-il réellement plus rien à croire ? Si d’autres senseis me déçoivent tout autant par leur humanité et leurs erreurs, quelle quête me reste-t-il à suivre ? Puisque tout meurt.
C’est par la publication de ce livre que j’ai appris que François Bœspflug, dominicain et professeur d’histoire de l’art reconnu – et presque vénéré en ce qui me concerne – a quitté l’Ordre dominicain. Renier son engagement ? Et quid alors de sa foi ? Ses écrits, son parcours, son engagement étaient jusqu’alors parmi les rares qui me faisaient dire qu’il y avait peut-être une réponse au non-sens, au néant, dans la foi catholique, ou dans la foi-tout-court, dans la recherche du sacré. Sa vision de la spiritualité m’invitait à croire en autre chose qu’à l’absurde. Il est à noter que l’acceptation de l’absurde me soigne ces temps-ci de bien des névroses, plus qu’une quelconque quête d’un dieu toujours absent. Mais alors, si François Bœspflug lui même renonce, n’existe-t-il réellement plus rien à croire ? Si d’autres senseis me déçoivent tout autant par leur humanité et leurs erreurs, quelle quête me reste-t-il à suivre ? Puisque tout meurt. Je remonte la piste «
Je remonte la piste «  Je prends mes lectures dans le désordre. Après avoir chroniqué
Je prends mes lectures dans le désordre. Après avoir chroniqué  Cette synthèse de plus de 1000 pages a pour titre complet Dieu, une enquête : judaïsme, christianisme, islam : ce qui les distingue, ce qui les rapproche. Dirigée par Dionigi Albera, anthropologue au CNRS, et Katell Berthelot, historienne des idées également au CNRS, elle a été rédigé par pas moins de 18 contributeurs de France, d’Allemagne, de Norvège et d’Italie, tous experts dans leurs disciplines (sociologie, histoire, anthropologie, théologie, philologie, islamologie, études juives, etc.) et membres de grands instituts de recherche européens.
Cette synthèse de plus de 1000 pages a pour titre complet Dieu, une enquête : judaïsme, christianisme, islam : ce qui les distingue, ce qui les rapproche. Dirigée par Dionigi Albera, anthropologue au CNRS, et Katell Berthelot, historienne des idées également au CNRS, elle a été rédigé par pas moins de 18 contributeurs de France, d’Allemagne, de Norvège et d’Italie, tous experts dans leurs disciplines (sociologie, histoire, anthropologie, théologie, philologie, islamologie, études juives, etc.) et membres de grands instituts de recherche européens.