 J’ai voulu lire les lettres de Franz Kafka à Milena pour connaître Milena. Mais la tâche ne fut pas si simple. A l’instar des Lettres à Felice, on y découvre un Kafka bien plus préoccupé par l’image qu’il se fait de sa correspondante que par la correspondante elle-même. Il dresse ici le portrait d’une Milena idéalisée et le reconnaît lui-même. Si l’aventure est moins perverse – j’ose le mot – qu’avec Felice, l’ambiguïté de cette correspondance est flagrante. Franz Kafka ne s’adresse qu’à lui-même et à ses propres fantômes.
J’ai voulu lire les lettres de Franz Kafka à Milena pour connaître Milena. Mais la tâche ne fut pas si simple. A l’instar des Lettres à Felice, on y découvre un Kafka bien plus préoccupé par l’image qu’il se fait de sa correspondante que par la correspondante elle-même. Il dresse ici le portrait d’une Milena idéalisée et le reconnaît lui-même. Si l’aventure est moins perverse – j’ose le mot – qu’avec Felice, l’ambiguïté de cette correspondance est flagrante. Franz Kafka ne s’adresse qu’à lui-même et à ses propres fantômes.
J’ai choisi tout de même de mener à son terme cette lecture fastidieuse. Je me souviens par ailleurs d’abominables lettres à Felice, et de cette sensation magnétique, ce besoin – pervers aussi ? – de lire un discours qui me débectait sans comprendre le fondement de ce besoin. Je me souviens, quelques semaines après avoir refermé le deuxième volume des Lettres à Felice, d’une impression très marquée et marquante d’être entrée dans un univers obsessionnel qui me rappelait fortement Le château ou La métamorphose – qu’est-ce que cet homme qui tel un cafard rampe sous les portes des chambres des demoiselles pour les regarder écrire dans leur dos ? – et l’impression était dix fois plus vive à la lecture de ces lettres qu’à la lecture des romans. J’ai donc mené à son terme la lecture des lettres à Milena et je ne le regrette pas. J’y ai trouvé mon compte sur l’interlocutrice. Le volume des éditions Nous se clôt par la rubrique nécrologique de Franz Kafka rédigée par Milena elle-même. Elle y dresse un portrait de l’écrivain saisissant. Elle n’a visiblement pas lu les lettres qu’elle a reçues de la même manière que moi. Elle les a reçues entrecoupées de rencontres bien réelles avec Kafka, elle les a accompagnées de lectures et de son travail de traduction en tchèque des œuvres fictionnelles de Franz Kafka. Sans s’attacher aux névroses de l’homme, elle a été capable d’en saisir et retenir le meilleur. A tel point que j’en ai regretté de ne pas pouvoir lire finalement les réponses à ces lettres qui s’étalent sur près de 3 ans. Les réponses de Milena s’adressaient très certainement à Franz Kafka-le-vrai et non à un Autre idéalisé, elle connaissait son interlocuteur et accordait une grande importance à la sincérité de leur relation… à moins que la lectrice que je suis ai retrouvé son propre idéal de Kafka dans l’écrit de Milena Jesenská et s’en trouve immensément et maladroitement rassurée.
A Milena – Franz Kafka
traduction de l’allemand et introduction par Robert Kahn
Nous, 2015, 320 p.
Merano, 15 juin 1920, mardi
Mardi
Ce matin tôt j’ai de nouveau rêvé de toi. Nous étions assis l’un à côté de l’autre et tu me repoussais, pas méchamment, aimablement. J’étais très malheureux. Pas d’être repoussé, mais à cause de moi, qui te traitais comme n’importe quelle femme muette et n’entendais pas la voix qui sortait de toi et me parlait précisément à moi. A moins peut-être que je l’aie bien entendue, mais je n’ai pas pu lui répondre. Je m’en allais plus desespéré que dans le premier rêve.
Il me revient à l’esprit ce que j’ai lu un jour chez quelqu’un : « Ma bien-aimée est une colonne de feu, qui parcourt la terre. En ce moment, elle me tient enlacé. Elle ne conduit pas ceux qu’elle enlace, mais ceux qui la voient. »
Ton
(Voilà que je perds même le nom, il s’est raccourci de plus en plus et maintenant il est devenu : ton )
♣♣♣
Prague 31 juillet 1920, samedi
Samedi, plus tard
De quelque façon que l’on retourne ta lettre d’aujourd’hui, ta chère lettre fidèle gaie, une promesse de bonheur, c’est tout de même une lettre de « sauveur ». Milena parmi les sauveurs ! (si j’en faisais partie aussi, serait-elle alors déjà avec moi ? Non, alors sûrement pas) Milena parmi les sauveurs, elle qui fait dans son propre corps l’expérience continuelle que l’on ne peut sauver l’autre que par son être et par rien d’autre. Et voilà qu’elle m’a déjà sauvé par son être et qu’elle essaye maintenant a posteriori avec d’autres moyens infiniment plus petits. Quand quelqu’un sauve un autre de la noyade, c’est naturellement une très grande action, mais quand après cela il lui offre en plus un abonnement à des cours de natation, quel sens cela a-t-il ? Pourquoi le sauveur joue-t-il la facilité, pourquoi ne veut-il pas toujours continuer à sauver l’autre par son être, son être-là toujours disponible, pourquoi veut-il renvoyerla tâche à des maîtres nageurs et à des hôteliers de Davos ? Et d’ailleurs, je pèse déjà 55,40 ! Et comment pourrais-je m’envoler, si nous nous tenons par la main ? Et si nous nous envolons tous les deux, qu’est-ce que cela fait alors ? Et de plus – c’est la pensée de base de ce qui précèse – je ne partirai plus jamais si loin de toi. Je viens juste de quitter les chambres plombées de Merano.
♣♣♣
Prague, 18, 19, 20 septembre 1920, samedi, dimanche et lundi
Samedi soir
Je n’ai pas encore reçu la lettre jaune, je la renverrai sans l’avoir ouverte.
S’il n’était pas bon d’arrêter maintenant de nous écrire c’est que je devrais me tromper effroyablement. Mais je ne me trompe pas Milena.
Je ne veux pas parler de Toi, non pas que cela ne me concerne pas, cela me concerne, mais je ne veux pas en parler.
Donc à propos de moi seulement : ce que Tu est pour moi Milena ce que Tu es pour moi au-delà de ce monde dans lequel nous vivons, cela, sur les lambeaux de papiers que je t’ai écrits tous les jours, cela ne s’y trouve pas. Ces lettres, telles qu’elles sont, n’aident à rien d’autres qu’à tourmenter, et si elles ne tourmentent pas, alors c’est encore pire. Elles n’aident à rien qu’à produite un jour de Gmünd, qu’à produire des incompréhensions, de la honte, une honte presque inaltérable. Je veux te voir aussi nettement que la première fois dans la rue, mais les lettres me distraient plus que toute la Lerchenfelderstrasse avec tout son bruit.
Mais cela n’est même pas décisif, ce qui est décisif c’est mon impuissance croissante, à cause des lettres, à surmonter les lettres, impuissance aussi bien par rapport à Toi qu’à moi – 1000 lettres de Toi et 1000 souhaits de moi ne me contrediront pas – et ce qui est décisif (peut-être à cause de cette impuissance, mais toutes les raisons sont ici dans l’obscurité) c’est la forte et irrésistible voix, littéralement ta voix, qui me somme de me taire.
Et voilà que tout ce qui te concerne est encore non-dit, cela se trouve il est vrai le plus souvent dans tes lettres (peut-être aussi dans la jaune ou plus exactement : dans le télégramme par lequel tu me demandes le renvoi de la lettre, à bon droit bien sûr) souvent dans ces passages que je crains, que je fuis comme le diable fuit le lien consacré.
♣♣♣
Prague, fin mars ou début mai 1922
Voilà si longtemps que je ne vous ai pas écrit, Madame Milena, et même aujourd’hui je n’écris qu’à la suite d’un hasard. Je n’aurais en fait pas à m’excuser de ne pas vous avoir écrit, vous savez bien à quel point je hais les lettres. Tout le malheur de ma vie, – ce qui ne veut pas dire que je me plains, mais que je veux faire une constatation dans l’intérêt général – vient, si l’on veut, des lettres ou de la possibilité d’en écrire. Les êtres humains ne m’ont presque jamais trompé, mais les lettres toujours, et, en fait, pas celles des autres mais les miennes. Dans mon cas, c’est un malheur particulier, dont je ne veux pas parler davantage, mais aussi en même temps un malheur général. La facilité de l’écriture des lettres – d’un point de vue simplement théorique – doit avoir causé une effroyable désagrégation des âmes dans le monde. C’est une fréquentation des fanntômes et, pas seulement du fantôme du destinataire mais aussi de son propre fantôme, qui se développe sous la main dans la lettre qu’on écrit, ou même dans une suite de lettres, quand une lettre durcit l’autre et peut la faire témoigner. Comment a-t-on pu en arriver à penser que les êtres humains pourraient se fréquenter grâce aux lettres ! On peut penser à quelqu’un d’éloigné et on peut saisir quelqu’un de proche, tout le reste est hors du pouvoir de l’être humain. Mais écrire des lettres, cela signifie se dénuder devant les fantômes, ce qu’ils attendent avidement. Les baisers écrits ne parviennent pas à destination, mais les fantômes les boivent sur le chemin jusqu’à la dernière goutte. Grâce à cette riche nourriture, ils se multiplient incroyablement. L’humanité le sent et lutte contre cela, et pour exclure le plus possible le fantomatique d’entre les êtres humains, pour atteindre la fréquentation naturelle, la paix des âmes, elle a inventé le train, l’auto, l’aéroplane, mais cela ne sert plus à rien, ce sont visiblement des inventions qui ont été faites dès la chute, l’adversaire est beaucoup plus calme et plus fort, il a inventé après la poste le télégraphe, le téléphone, la télégraphie sans fil. Les fantômes ne mourront pas de faim, mais nous serons anéantis. […]
♣♣♣
Propos de Milena rapportés par Kafka :
« Pourquoi les êtres humains ne se promettent-ils pas qu’ils ne se crieront pas dessus lorsque le rôti sera trop brûlé »
« Pourquoi ne se promettent-ils pas de se laisser l’un à l’autre la liberté du silence, la liberté de la solitude, la liberté de l’espace ouvert? »
« Ou bien affronter son destin… avec humilité… ou bien chercher son destin…
– … la foi est nécessaire pour chercher ! »
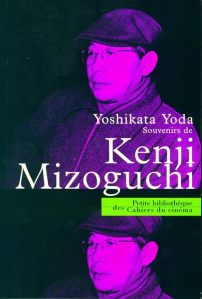


 Un échange de clic sur le blog de Stéphane Chabrières,
Un échange de clic sur le blog de Stéphane Chabrières, 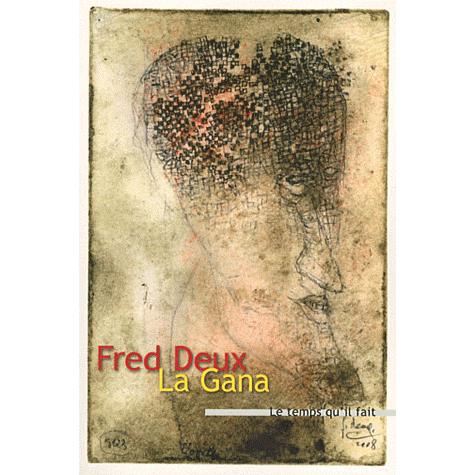 Lire La Gana, c’est avant tout, le vouloir. 950 pages en tout petit caractère. Le livre n’est pas « confortable » ni dans la forme ni dans le fond. Il ne s’adresse pas à tout le monde. Il s’adresse à qui veut bien voir et à qui a le cœur bien accroché.
Lire La Gana, c’est avant tout, le vouloir. 950 pages en tout petit caractère. Le livre n’est pas « confortable » ni dans la forme ni dans le fond. Il ne s’adresse pas à tout le monde. Il s’adresse à qui veut bien voir et à qui a le cœur bien accroché. Le vers en titre de ce livre magnifique n’est pas de Serge Airoldi. Ce dernier l’a emprunté à Edmond Henri-Crisinel, poète suisse de la première moitié du XXème siècle. Le contenu du livre n’en est pas moins à la hauteur de cette déchirante mise en bouche. La route que nous décrit Serge Airoldi suit un « fleuve tout en nuit » du Gers de l’enfance au pays d’Adour, lieu de vie de l’auteur, et dont les détours traversent les continents. De souvenirs en paysages, de paysages en rencontres, de rencontres en ravages, le lecteur chemine avec Serge Airoldi dans sa maison d’enfance, dans les maquis de la seconde guerre mondiale, dans les ventes aux enchères où l’on dilapide les biens d’une personne aimée, dans des jardins fleuris près desquels paissent les troupeaux de vaches ou de chevaux. Le long de l’Adour ou au pied du Ventoux – à l’instar de Philippe Jaccottet dans ses
Le vers en titre de ce livre magnifique n’est pas de Serge Airoldi. Ce dernier l’a emprunté à Edmond Henri-Crisinel, poète suisse de la première moitié du XXème siècle. Le contenu du livre n’en est pas moins à la hauteur de cette déchirante mise en bouche. La route que nous décrit Serge Airoldi suit un « fleuve tout en nuit » du Gers de l’enfance au pays d’Adour, lieu de vie de l’auteur, et dont les détours traversent les continents. De souvenirs en paysages, de paysages en rencontres, de rencontres en ravages, le lecteur chemine avec Serge Airoldi dans sa maison d’enfance, dans les maquis de la seconde guerre mondiale, dans les ventes aux enchères où l’on dilapide les biens d’une personne aimée, dans des jardins fleuris près desquels paissent les troupeaux de vaches ou de chevaux. Le long de l’Adour ou au pied du Ventoux – à l’instar de Philippe Jaccottet dans ses  Voici l’histoire de deux sœurs, Anne et Claire, qui entreprennent de retracer l’histoire de la branche maternelle de leur famille, longtemps méconnue. Lélia, leur mère, est fille d’un certain Vicente suicidé à 27 ans, de son vrai nom Lorenzo Picabia – lui-même né du couple Gabriële et Francis Picabia. Et nous touchons là l’objet de cette biographie à peine romancée, la vie du rocambolesque et génial couple d’artistes. Francis Picabia, le peintre, et sa musicienne d’épouse qui donne son titre au récit. Anne et Claire Berest tentent ici de redonner ses lettres de noblesse à la femme de l’ombre qui abandonna tôt la musique pour se consacrer entièrement à l’art de la maïeutique – l’accoucheuse de Francis Picabia jusqu’alors engoncé dans de pâles imitations impressionnistes, le fantasme du jeune Marcel que l’on nommera plus volontiers Duchamp après émancipation, l’amie sincère de Guillaume qui n’aura pas eu besoin d’elle pour être déjà Apollinaire.
Voici l’histoire de deux sœurs, Anne et Claire, qui entreprennent de retracer l’histoire de la branche maternelle de leur famille, longtemps méconnue. Lélia, leur mère, est fille d’un certain Vicente suicidé à 27 ans, de son vrai nom Lorenzo Picabia – lui-même né du couple Gabriële et Francis Picabia. Et nous touchons là l’objet de cette biographie à peine romancée, la vie du rocambolesque et génial couple d’artistes. Francis Picabia, le peintre, et sa musicienne d’épouse qui donne son titre au récit. Anne et Claire Berest tentent ici de redonner ses lettres de noblesse à la femme de l’ombre qui abandonna tôt la musique pour se consacrer entièrement à l’art de la maïeutique – l’accoucheuse de Francis Picabia jusqu’alors engoncé dans de pâles imitations impressionnistes, le fantasme du jeune Marcel que l’on nommera plus volontiers Duchamp après émancipation, l’amie sincère de Guillaume qui n’aura pas eu besoin d’elle pour être déjà Apollinaire. J’ai voulu lire les lettres de Franz Kafka à Milena pour connaître Milena. Mais la tâche ne fut pas si simple. A l’instar des Lettres à Felice, on y découvre un Kafka bien plus préoccupé par l’image qu’il se fait de sa correspondante que par la correspondante elle-même. Il dresse ici le portrait d’une Milena idéalisée et le reconnaît lui-même. Si l’aventure est moins perverse – j’ose le mot – qu’avec Felice, l’ambiguïté de cette correspondance est flagrante. Franz Kafka ne s’adresse qu’à lui-même et à ses propres fantômes.
J’ai voulu lire les lettres de Franz Kafka à Milena pour connaître Milena. Mais la tâche ne fut pas si simple. A l’instar des Lettres à Felice, on y découvre un Kafka bien plus préoccupé par l’image qu’il se fait de sa correspondante que par la correspondante elle-même. Il dresse ici le portrait d’une Milena idéalisée et le reconnaît lui-même. Si l’aventure est moins perverse – j’ose le mot – qu’avec Felice, l’ambiguïté de cette correspondance est flagrante. Franz Kafka ne s’adresse qu’à lui-même et à ses propres fantômes.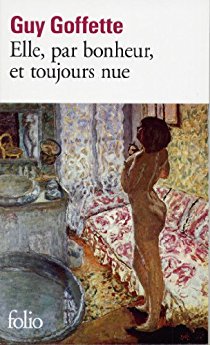 C’est au cours d’un mois belge que j’ai eu connaissance pour la première fois des écrits de Guy Goffette. Dans la foulée et en accordant toute ma confiance à l’une ou l’autre blogueuse –
C’est au cours d’un mois belge que j’ai eu connaissance pour la première fois des écrits de Guy Goffette. Dans la foulée et en accordant toute ma confiance à l’une ou l’autre blogueuse –  C’est par la publication de ce livre que j’ai appris que François Bœspflug, dominicain et professeur d’histoire de l’art reconnu – et presque vénéré en ce qui me concerne – a quitté l’Ordre dominicain. Renier son engagement ? Et quid alors de sa foi ? Ses écrits, son parcours, son engagement étaient jusqu’alors parmi les rares qui me faisaient dire qu’il y avait peut-être une réponse au non-sens, au néant, dans la foi catholique, ou dans la foi-tout-court, dans la recherche du sacré. Sa vision de la spiritualité m’invitait à croire en autre chose qu’à l’absurde. Il est à noter que l’acceptation de l’absurde me soigne ces temps-ci de bien des névroses, plus qu’une quelconque quête d’un dieu toujours absent. Mais alors, si François Bœspflug lui même renonce, n’existe-t-il réellement plus rien à croire ? Si d’autres senseis me déçoivent tout autant par leur humanité et leurs erreurs, quelle quête me reste-t-il à suivre ? Puisque tout meurt.
C’est par la publication de ce livre que j’ai appris que François Bœspflug, dominicain et professeur d’histoire de l’art reconnu – et presque vénéré en ce qui me concerne – a quitté l’Ordre dominicain. Renier son engagement ? Et quid alors de sa foi ? Ses écrits, son parcours, son engagement étaient jusqu’alors parmi les rares qui me faisaient dire qu’il y avait peut-être une réponse au non-sens, au néant, dans la foi catholique, ou dans la foi-tout-court, dans la recherche du sacré. Sa vision de la spiritualité m’invitait à croire en autre chose qu’à l’absurde. Il est à noter que l’acceptation de l’absurde me soigne ces temps-ci de bien des névroses, plus qu’une quelconque quête d’un dieu toujours absent. Mais alors, si François Bœspflug lui même renonce, n’existe-t-il réellement plus rien à croire ? Si d’autres senseis me déçoivent tout autant par leur humanité et leurs erreurs, quelle quête me reste-t-il à suivre ? Puisque tout meurt.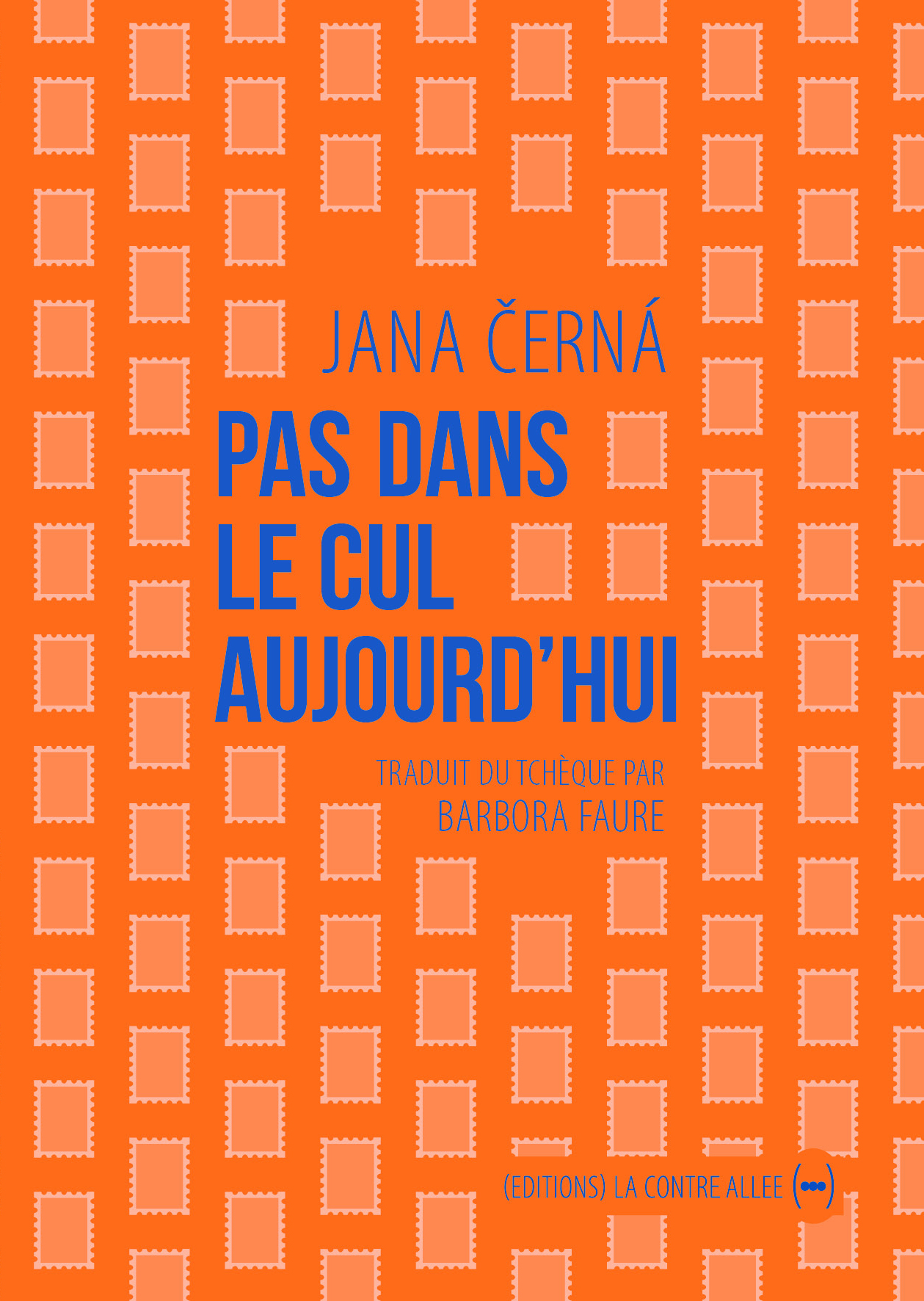 Littérature tchèque à l’honneur ce jour. Pas dans le cul aujourd’hui est une lettre de Jana Černá à son mari Egon Bondy écrite à Prague aux environ de 1962 sous l’ère communiste. Elle se lit en moins d’une heure et soulève des tempêtes, aiguise l’intellect, pourrait être provocante, se contente d’exprimer une pensée totalement et démesurément libre. Jana Černá est la fille de la journaliste, écrivaine et traductrice tchèque Milena Jesenská, célèbre destinataire des Lettres à Milena de
Littérature tchèque à l’honneur ce jour. Pas dans le cul aujourd’hui est une lettre de Jana Černá à son mari Egon Bondy écrite à Prague aux environ de 1962 sous l’ère communiste. Elle se lit en moins d’une heure et soulève des tempêtes, aiguise l’intellect, pourrait être provocante, se contente d’exprimer une pensée totalement et démesurément libre. Jana Černá est la fille de la journaliste, écrivaine et traductrice tchèque Milena Jesenská, célèbre destinataire des Lettres à Milena de 

